Hydrogène Vert au Brésil : De la Promesse à la Réalité Économique et Industrielle
- Fernando Caneppele

- 24 juil.
- 6 min de lecture
Par Prof. Fernando Caneppele (Université de São Paulo)Juillet 2025

Nous sommes à un moment charnière pour l’agenda énergétique et industriel du Brésil. Dans un contexte mondial marqué par une quête effrénée de sécurité énergétique et de chaînes d’approvisionnement résilientes, la transition vers des sources propres n’est plus une simple question environnementale, mais est devenue un pilier de la géopolitique moderne.
Alors que la COP30 à Belém approche à grands pas, les regards du monde se tournent vers le Brésil, non seulement comme gardien de biomes essentiels, mais aussi comme un acteur potentiel majeur de la nouvelle économie décarbonée. Cette conjoncture exerce une double pression sur le pays : une « pression externe » liée à la demande internationale de décarbonation, et une « pression interne » née du besoin de réindustrialisation, d’innovation et de sécurité énergétique.
Dans ce contexte, aucun sujet n’illustre mieux notre potentiel et nos défis que l’hydrogène vert (H2V). Pendant des années, nous avons discuté des avantages comparatifs du Brésil : un mix électrique bas carbone, une abondance de soleil et de vent, et une vaste étendue territoriale. La promesse de transformer ces dons naturels en leadership mondial dans la production d’H2V a alimenté mémorandums d’entente et de nombreux congrès.
Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si le Brésil peut être un leader, mais comment nous allons passer de la promesse à la réalité industrielle et économique. L’H2V doit être considéré non comme une simple matière première, mais comme une « molécule-plateforme », la base sur laquelle un nouvel écosystème industriel sophistiqué peut être construit. L’époque des études de potentiel fait place à l’urgence de l’exécution. Le succès dépendra d’une approche pragmatique axée sur les défis d’échelle, de coûts, de développement de marché, d’infrastructures et, surtout, de création d’une chaîne de valeur compétitive.
Le défi de l’échelle et de la compétitivité des coûts
La viabilité de l’H2V repose avant tout sur la question de l’échelle et sur un casse-tête de coûts. La métrique clé est le Coût Nivelé de l’Hydrogène (LCOH), qui intègre non seulement le coût de l’électricité renouvelable, mais aussi les investissements en capital dans les électrolyseurs (CAPEX), les coûts d’exploitation et de maintenance (OPEX) et, fondamentalement, le facteur de capacité de l’usine.
C’est ici que le Brésil brille grâce à un double avantage compétitif : non seulement le prix de notre énergie renouvelable est bas, mais le facteur de capacité de nos parcs éoliens, notamment dans le Nord-Est, est parmi les plus élevés au monde, permettant aux coûteux électrolyseurs de fonctionner plus d’heures par an, ce qui dilue leur coût fixe sur plus de kilogrammes d’hydrogène produit.
Cependant, le CAPEX des électrolyseurs reste le principal obstacle.
Le choix technologique – qu’il s’agisse de la technologie alcaline (ALK) plus mature, de la membrane échangeuse de protons (PEM) plus flexible, ou de la technologie émergente à oxyde solide (SOEC) implique des coûts, des efficacités et une dépendance à des minerais critiques comme le platine et l’iridium différents. La chaîne d’approvisionnement mondiale de ces équipements est concentrée en Chine et en Europe, exposant notre programme naissant à des risques de volatilité des prix et de goulets d’étranglement logistiques. L’adoption du cadre juridique sur l’hydrogène (Loi n° 14.948/2024) fut une étape cruciale, offrant la sécurité juridique nécessaire pour débloquer des dizaines de milliards de reais d’investissements prévus. Le rôle de la BNDES doit maintenant dépasser le simple financement direct, en agissant comme catalyseur via des mécanismes de financement mixte (blended finance) et des garanties afin d’attirer le capital privé national et international encore hésitant face aux risques initiaux. L’année 2025 s’annonce comme celle où les premiers grands projets dans les complexes portuaires tels que Pecém (CE) et Açu (RJ) passeront enfin à la décision finale d’investissement.
Construire des marchés : le pilier domestique et la vitrine mondiale
Une stratégie de marché réussie pour l’H2V doit être double, équilibrant ambitions d’exportation et création d’une demande interne forte et résiliente.
Le marché d’exportation est la vitrine qui attire les grands investissements. L’Union européenne, avec ses nouvelles réglementations strictes, n’achète pas simplement de l’hydrogène ; elle achète des Carburants Renouvelables d’Origine Non Biologique (RFNBO) qui doivent respecter des critères rigoureux d’additionnalité ainsi que de corrélation temporelle et géographique.
Cela signifie que notre production devra être accompagnée d’un système robuste de certification pour prouver ses « crédentials verts », un défi bureaucratique et technique en soi. La conversion de l’H2V en dérivés plus facilement transportables, comme l’ammoniac vert et le méthanol vert, est la voie la plus pragmatique vers ce marché, bien qu’elle ajoute des coûts et des pertes d’efficacité. Dans ce contexte, nous faisons face à une forte concurrence de pays à fort potentiel comme le Chili, l’Australie et les pays du Moyen-Orient, rendant la rapidité et la compétitivité cruciales.
Cependant, c’est le marché intérieur qui servira de véritable ancrage à notre industrie de l’H2V. Ancrer la production sur une demande locale prévisible est une question de stratégie intelligente, réduisant l’exposition aux fluctuations monétaires et géopolitiques. La véritable récompense est d’utiliser l’H2V pour décarboner notre propre industrie. Pour l’agro-industrie, qui importe des milliards de dollars en engrais azotés, la production locale d’ammoniac vert est une politique de sécurité alimentaire qui réduit l’exposition à la volatilité des prix du gaz naturel.
Pour la sidérurgie, l’utilisation de l’H2V dans le processus de réduction directe du fer (DRI) peut générer de « l’acier vert », un produit à très haute valeur ajoutée dont la demande mondiale est croissante. Le Programme récemment institué pour le développement de l’hydrogène à faible émission de carbone (PHBC), avec ses incitations fiscales, est l’outil adéquat pour stimuler cette transition, rendant également possibles les applications futures dans les carburants synthétiques pour l’aviation et le transport maritime.
La logistique d’une nouvelle énergie
La molécule d’hydrogène est petite et énergétique, mais notoirement difficile à stocker et transporter. L’infrastructure logistique est peut-être le talon d’Achille de l’économie de l’hydrogène à l’échelle continentale. Transporter l’H2V des pôles de production du Nord-Est vers les centres industriels du Sud-Est ou les ports d’exportation exige une réorganisation logistique monumentale.
L’adaptation du réseau de gazoducs existant fait face à des défis techniques importants, comme la fragilisation par l’hydrogène qui rend l’acier des tuyaux cassant, et la nécessité de nouvelles stations de compression. La construction d’un nouveau réseau de « hydrogénoducs » est la solution idéale à long terme, mais représente un investissement colossal avec un temps de maturation de plusieurs décennies. Cela renforce l’argument en faveur d’un développement initial basé sur des « hubs » ou « clusters ».
Des ports tels que Pecém et Açu se positionnent non seulement comme des points d’embarquement, mais comme des écosystèmes intégrés où la production d’énergie renouvelable offshore, la production d’H2V, la synthèse de dérivés comme l’ammoniac, et la consommation par des industries adjacentes (sidérurgie, cimenterie, chimie) se produisent dans un rayon géographique limité. Ce modèle de co-localisation minimise la nécessité de transport longue distance et crée des économies d’échelle et de portée, optimisant toute la chaîne de valeur en un seul lieu. Des solutions de stockage géologique, comme dans des cavernes salines, devront également être explorées pour garantir la stabilité de l’approvisionnement.
La chaîne de valeur : De la commodity à la souveraineté technologique
Le plus grand risque pour le Brésil serait de se contenter d’un rôle néocolonial de simple exportateur d’une molécule verte, une commodité à faible valeur ajoutée. La leçon douloureusement apprise avec l’industrie des panneaux solaires, dans laquelle nous sommes devenus des utilisateurs massifs de technologie importée, ne doit pas se répéter. La véritable opportunité stratégique, le cœur d’une politique industrielle pour le XXIe siècle, réside dans le renforcement de la chaîne de production de l’H2V.
Cela signifie stimuler activement, avec des politiques claires et continues, la fabrication locale de ses composants les plus nobles : électrolyseurs, piles à combustible, réservoirs de stockage et systèmes de contrôle. Le gouvernement doit utiliser son pouvoir d’achat et ses programmes d’incitation, comme le PHBC, pour exiger des objectifs de contenu local et de transfert de technologie, attirant des fabricants mondiaux à produire ici tout en permettant aux entreprises brésiliennes de devenir compétitives. Maîtriser la technologie abaisse non seulement le coût final de notre hydrogène et nous protège des chocs externes, mais génère aussi des emplois hautement qualifiés et positionne le Brésil comme exportateur d’équipements et de services d’ingénierie. Parallèlement, une mobilisation nationale pour la formation de capital humain est impérative. Nous avons besoin d’une génération d’ingénieurs, de chimistes, de techniciens et d’experts en sécurité « prêts pour l’hydrogène », un effort demandant une collaboration sans précédent entre industrie, gouvernement et institutions éducatives et de recherche.
Conclusion
Le Brésil, à la mi-2025, est à l’aube d’une nouvelle ère énergétique et industrielle. Les bases essentielles sont posées : un cadre réglementaire, des projets de grande envergure financés et une stratégie de marché définie.
Le moment est venu d’une exécution implacable, d’une coordination et d’une vision à long terme. Transformer le potentiel de l’hydrogène vert en une réalité industrielle et économique est l’impératif de notre temps, une opportunité unique de réindustrialiser le pays sur des bases durables et d’assurer un rôle durable dans la nouvelle géopolitique de l’énergie. Le chemin est complexe, semé de défis techniques et financiers. Pourtant, l’inaction serait une erreur historique d’une ampleur incommensurable. Construire cet avenir requiert un consensus national et une détermination sans faille pour enfin convertir notre potentiel en prospérité et en influence.
Hydrogène Vert au Brésil : De la Promesse à la Réalité Économique et Industrielle
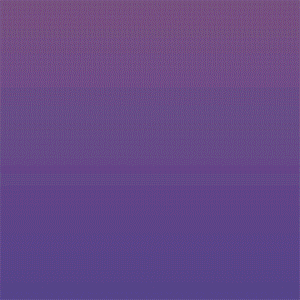






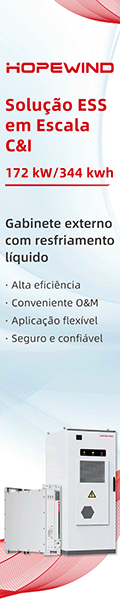
Commentaires